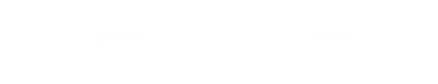Dette de 1825 : La vérité ne suffit plus. Il faut la justice.

Il y a des décisions qui ne vieillissent pas. Elles hantent les siècles, nourrissent les fractures, structurent les inégalités. Celle prise en 1825 par le roi Charles X, au nom de la France, fait partie de ces injustices qui n’ont jamais été digérées. Deux siècles plus tard, leur poison irrigue encore les fondations de l’État haïtien. En échange de la reconnaissance de son indépendance, Haïti, première République noire du monde libre, fut contrainte – sous la menace d’une escadre armée – de verser à la France une indemnité de 150 millions de francs-or. Un tribut arraché par la force, officialisé par la diplomatie, et payé jusqu’au dernier sou par un pays exsangue.
Ce jeudi 17 avril 2025, à l’occasion du bicentenaire de cette dette coloniale, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d’une commission d’historiens haïtiens et français pour étudier l’impact de cette « indemnité » et émettre des recommandations. En surface, le geste semble noble. Mais il pose une question simple : peut-on se contenter d’un diagnostic quand la plaie saigne encore ?
La dette de 1825 ne fut pas une dette contractée, elle fut une dette imposée. Une punition économique pour avoir osé se libérer. Ce fardeau initial a structuré le sous-développement haïtien. Pour payer, Haïti s’est endettée à taux usuraire auprès de banques françaises. Le remboursement s’est étalé jusqu’en 1952. Pendant ce temps, des écoles n’ont pas été construites, des hôpitaux n’ont pas été ouverts, des routes sont restées impraticables. Ce n’est pas une abstraction historique : c’est un crime économique dont les effets sont encore mesurables à l’œil nu.
Si la création de cette commission représente un tournant dans la rhétorique franco-haïtienne, elle ne saurait être une fin en soi. La mémoire sans réparation est une forme raffinée de mépris. Haïti n’a pas besoin d’être regardée avec compassion. Elle a besoin d’être entendue avec équité. Car si cette dette avait été moralement indéfendable en 1825, elle est aujourd’hui juridiquement insoutenable et politiquement irréconciliable avec toute notion de partenariat juste entre États.
La question qui se pose désormais n’est plus : “Que s’est-il passé ?” mais bien : “Qu’allons-nous faire de cette vérité ?” La reconnaissance ne peut être que le premier pas. Ce que l’Histoire appelle désormais, ce que la jeunesse haïtienne attend, c’est un acte de réparation clair, concret et à la hauteur du préjudice subi.
Refuser cette évidence serait prolonger l’humiliation. L’embrasser, c’est ouvrir la voie à une nouvelle forme de relation – non plus fondée sur le silence, mais sur la vérité, la justice et le respect mutuel.
TekTek appelle à un sursaut citoyen. À une vigilance collective. À une parole ferme et éclairée de la part de l’État haïtien. Car on ne bâtit pas une République solide sur une dette illégitime. On la bâtit sur la vérité restaurée, les droits reconnus, et la mémoire transformée en justice.
Abonnez-vous à TekTek sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos enquêtes, dossiers et analyses :
Twitter/X : @iam_tektek
Threads : @iam_tektek
Instagram : @iam_tektek
Chaîne WhatsApp : TekTek sur WhatsApp